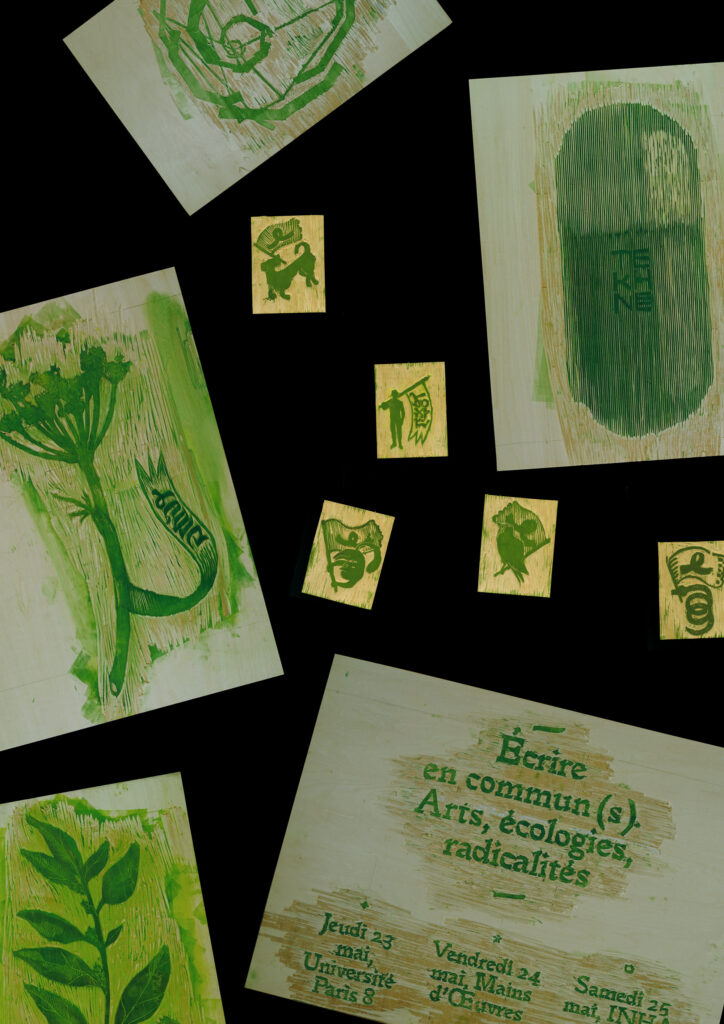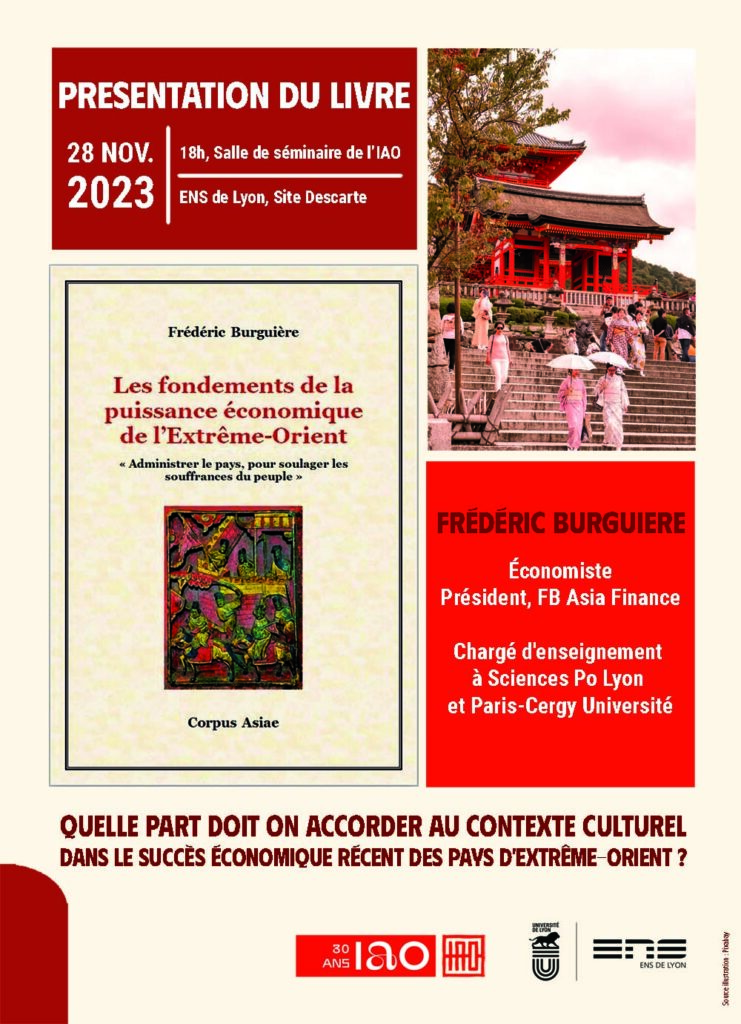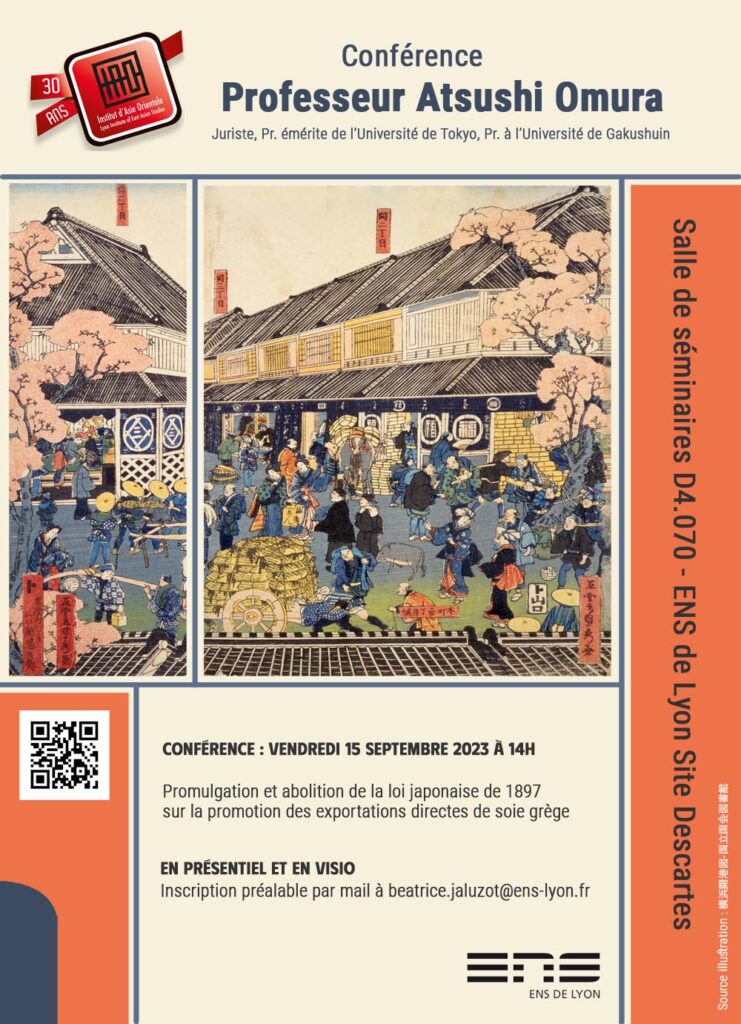La société vietnamienne au début du XXe siècle est marqué par un double mouvement : d’une part, les lettrés modernistes appellent à boycotter les concours mandarinaux, d’autre part, les candidats aux concours espèrent encore le retour triomphal au village en cas de réussite. En lisant les Nouveaux Ecrits (Tân Thư), des textes en chinois présentant le Meiji au Japon, la situation en Chine, et surtout la civilisation occidentale avec les philosophes emblématiques dont Montesquieu et Rousseau, les modernistes ont compris les limites de la lutte traditionnelle anti-française et ont suivi avec enthousiasme l’exemple de modernisation japonaise et chinoise. Ils préconisent les actions dans les domaines divers, selon les principes giáo dân, dưỡng dân, tân dân (éduquer le peuple, l’enrichir et le moderniser) : l’éducation avec l’ouverture d’écoles privées, l’économie avec la création de coopératives et d’entreprises d’artisanat, mais aussi la modernisation des mœurs, comme couper les cheveux ou porter des vêtements à l’occidental taillés dans des tissus de fabrication vietnamienne. Cet élan de modernisation porté par une partie de l’élite vietnamienne s’inscrit dans un contexte régional marqué en 1905 par la victoire du Japon sur la Russie et par une nouvelle politique d’association décidée par la France également en début 1905, cela jusqu’en 1908 quand le changement de conjoncture arrête net les initiatives modernistes. Le programme moderniste est motivé par la prise de conscience du retard du Viêtnam et par la volonté de prendre en main sa destinée, en sonnant le « réveil » pour inciter les lecteurs à passer à l’action. Que veut dire cependant « moderniser » ? Les Vietnamiens n’ont-ils pas à leur disposition des ressources propres ? Dans ce Vietnam colonisé depuis un demi-siècle, quel rôle la France a-t-elle joué ?
Des recherches s’écartant de la perspective de la lutte pour l’indépendance mettent en évidence la complexité de la modernité au Vietnam.
Les idées des Lumières, notamment celles de Rousseau, ont été popularisées surtout par les lettrés modernistes qui ont lu des textes en caractères chinois, et non pas par les nouveaux diplômés qui pouvaient pourtant le lire en français. Dans le contexte d’une société coloniale, le « contrat social » (khế ước xã hội), mais peut-être surtout l’idée du peuple souverain (dân quyền, droits du peuple), trouvent sans doute un écho particulier dans cet ancien Đại Nam divisé par le pouvoir colonial en trois « pays » aux régimes distincts (Annam et Tonkin sous le régime du protectorat, Cochinchine en tant que colonie).
Les acteurs étaient également très divers, avec leurs intérêts propres, mais leurs actions pouvaient entrer en synergie à un moment donné. Les lettrés modernistes ont critiqué très sévèrement les mandarins, mais la réalité est qu’une partie du mandarinat, notamment le haut mandarinat du Tonkin (nord Vietnam) a joué rôle actif dans la modernisation du système d’enseignement et de formation du personnel mandarinal. Des nouveaux diplômés témoignaient également d’un grand dynamisme en faveur de la modernisation : Nguyễn Văn Vĩnh a démissionné de son poste du secrétaire-interprète et a lancé le premier journal en vietnamien à Hanoi ; la Société d’Enseignement mutuel du Tonkin a organisé des conférences et des cours gratuits.
Il est important de souligner le fait que malgré le mot générique Duy Tân (modernisation), il s’agit non pas d’un mouvement bien structuré, mais plutôt d’une sensibilité partagée par des gens très différents – lettrés de formation classique, nouveaux diplômés francophones, mandarins réformateurs, entrepreneurs – unis dans l’idée de faire évoluer leur pays, dans la perspective de retrouver un jour la maîtrise de son destin collectif.
Les actions modernistes se déployaient également en différents lieux. Bien que l’emblématique école Đông Kinh Nghĩa Thục, fondée à Hanoï au nord en 1907, est la plus connue, les initiatives ont été nombreuses ailleurs, notamment dans le centre. Le célèbre poème pour « réveiller » ceux qui sont encore égarés dans la préparation des concours mandarinaux, circulait dès 1905 et dans le centre. Dans un village proche de Đà Nẵng, un village dirigé par un « maire » moderniste appliquait des idées du lettré Phan Châu Trinh, en ouvrant une école, créant une bibliothèque et encourageant l’artisanat.
Nous nous interrogeons sur la place de Hué, en tant que capitale impériale, et la région du centre (Annam à l’époque coloniale), dans ce mouvement de modernisation (canh tân, duy tân) qui a transformé le pays et a donné naissance au Vietnam moderne. Hué était-elle toujours à l’image d’une Cour royale conservatrice et d’une belle capitale « endormie » ?
Des indices montrent que Hué s’est montrée très dynamique et innovante à différents moments de l’histoire, notamment à la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle, quand les nouvelles du Meiji japonais et du néoconfucianisme chinois sont arrivées en Indochine française.
Prenons l’exemple de l’empereur Thành Thái qui a régné de 1889 à 1907. Peu connu en réalité et souffrant d’une mauvaise réputation, il se montrait tout à fait ouvert à la civilisation de l’Occident. L’empereur possédait par exemple une grande bibliothèque riche de Nouveaux Ecrits à laquelle quelques personnes avaient l’accès. Avant d’être contraint de céder son trône à son fils de sept ans, choisi par les autorités coloniales pour accompagner le changement social sous le nom de règne de Duy Tân (écrit avec les mêmes caractères chinois anciens que le Meiji), il semble avoir favorisé un certain nombre d’actions en faveur de la modernisation de la société vietnamienne. Il reste beaucoup à faire pour comprendre les idées de cet empereur déchu et celles de son environnement, ainsi que les années qui ont suivi. Malgré son retrait du pouvoir, le règne de son fils, du 5 septembre 1907 au 10 mai 1916, n’était pas entièrement maîtrisé par le pouvoir colonial, comme le montre la révolte du jeune empereur Duy Tân en plein Première Guerre mondiale, quand les troupes des militaires et engagés vietnamiens quittaient l’Indochine pour la France.
Bien que cela peut paraître paradoxal, c’est à Hué, capitale impériale et lieu réputé pour être le plus conservateur, qu’on pouvait trouver ces écrits appelant au changement. Phan Bội Châu y a rencontré, aux alentours de 1900, Nguyễn Thượng Hiền qui « conservait en secret les écrits de Nguyễn Lộ Trạch qu’il n’avait jamais montré à personne ». Phan Chau Trinh, reçu vice-docteur en 1901, était moins présent à son bureau au ministère des Rites que d’aller « lire les nouveaux écrits, discuter avec Đào Nguyên Phổ et Thân Trọng Huề ». Quant à Huỳnh Thúc Kháng, c’est seulement à l’âge de vingt-neuf ans et après avoir été reçu docteur qu’il a eu l’occasion de lire des Nouveaux Ecrits chez Đào Nguyên Phổ. Convaincu par ces lectures, il a pris la voie de la modernisation en refusant la carrière mandarinale toute tracée.
D’après le témoignage de Huỳnh Thúc Kháng, c’est autour de 1903-1904 que les idées commencent à circuler plus ouvertement. Les grands rassemblements pendant les périodes de concours littéraires favorisent d’ailleurs la transmission des idées. Quand des milliers de lettrés se rassemblent au même moment à un même endroit, une nouvelle peut se propager à une grande vitesse. Il faut également garder à l’esprit qu’autour des lettrés existe tout un monde de serviteurs (qui portent leurs équipements) et de marchands (de papier, d’encre, d’auberges, etc.). Par ces relais, une information peut se diffuser dans d’autres groupes sociaux. Dans une société ignorant encore la presse écrite, le rôle de la báo miệng (presse orale), est essentiel.
Plus tard, les imprimeries et les maisons d’édition ne manquent pas à Hué. C’est à Hué même que Huỳnh Thúc Kháng, après avoir purgé sa peine par suite de sa condamnation en raison des manifestations anti-impôt en 1908, a choisi de fonder l’emblématique journal Tiếng Dân (La Voix du peuple). Đào Duy Anh y a créé sa maison d’édition et a diffusé des idées marxistes dans ses dictionnaires. Ces faits sont bien connus, mais il nous manque des études plus fines, en exploitant notamment des archives publiques désormais plus accessibles, mais aussi des archives familiales ou celles des lieux comme des pagodes et églises.
Les initiatives dans le domaine de l’économie sont également une thématique prometteuse. Contrairement à la philosophie confucéenne qui met le « commerçant » en bas de la société, la création de nombreuses sociétés commerciales à Hué même ou dans la région révèle un changement profond de mentalité. Les alliances matrimoniales entre différents milieux peuvent être par exemple un signe du temps : le mariage d’un membre de la famille royale avec une jeune femme d’une grande famille commerçante peut être révélateur de l’adoption des idées et des pratiques très différentes de ce qui avait cours dans le passé. La formation professionnelle est également une nouveauté : enseigner un métier dans un cadre de scolaire n’allait pas de soi, les villages de métiers gardaient leur secret de fabrication. Le roi Thành Thái semble être à l’origine de la création d’une école professionnelle avec l’objectif de valoriser des métiers traditionnels. C’est d’ailleurs à Hué que Mme Đạm Phương a créé son association Nữ công Học hội qui enseigne les arts ménagers et encourage les femmes à devenir autonomes économiquement afin de lutter pour leurs droits et leur liberté. Des foires d’exposition de produits artisanaux à Hué et dans d’autres centres urbains du centre sont également d’un grand intérêt pour étudier d’une façon approfondie les chemins empruntés par les partisans de la modernisation.
Dans ce processus, il convient de garder à l’esprit l’existence des intermédiaires venant d’ailleurs : des Chinois (propriétaires de bibliothèque ou de librairie), des Français (la Ligue des Droits de l’Homme par exemple). Il faut également se poser la question sur les liens personnels réels qui peuvent se lier entre des catholiques et des non catholiques, malgré l’isolement possible de la communauté catholique en situation coloniale par rapport à d’autres fractions dans la société. Ceux qui voyaient d’un lieu à un autre, emmenant avec eux des écrits et imprimés, des objets, peuvent être ces intermédiaires favorisant la modernisation. Un fondeur, Ishikawa Kunichiro Minao (1871-1945), ancien étudiant de l’Université des beaux- arts de Tokyo, a pu jouer ce rôle. Appelé par le gouvernement général de l’Indochine en 1901 pour enseigner dans une école professionnelle au Tonkin, il a fait sa carrière en Indochine, produisantaussi bien des œuvres monumentales pour les commandes publiques (restauration/copies d’œuvres vietnamiennes en bronze) que pour les particuliers (bibelots décoratifs), formant ainsi à son art ses apprentis vietnamiens. Une étude fine serait d’un grand intérêt pour mieux connaître ces circulations d’idées, de pratiques et de techniques. Une autre figure qui a marqué l’histoire de Hué comme celle du Vietnam en général : le bulletin Les Amis du Vieux Hué créé par le père Léopold Cadière, en s’intéressant à la culture de Hué, contribue à constituer un patrimoine vietnamien.
Le colloque international Les processus de modernisation à Hué et dans le centre du Vietnam à l’époque française ouvre en 2023 une série de colloques internationaux qui s’intéressera, dans les éditions suivantes, aux questions franco-vietnamienne à l’époque française. Ce premier colloque se propose de se concentrer sur la modernisation (canh tân, duy tân) et des réformes dans des différents domaines à Hué et dans le centre du Vietnam, en relation avec les événements au nord et au sud. La limitation géographique est volontaire, afin d’encourager des recherches approfondies qui apporteraient de nouvelles connaissances. Les sujets suivants, non exclusifs, seront abordés :
– diffusion des idées en faveur de la modernisation : concepts, acteurs, lieux, réseaux, circulations ;
– activités en faveur de l’éducation féminine et le rôle de la femme dans la société ;
– initiatives dans les domaines de l’éducation et de formation professionnelle ;
– initiatives dans le domaine de l’imprimerie, de l’édition et de la presse ;
– modernité dans la pensée économique, politique, religieuse ;
– migrations et mouvements de population, notamment les recrutements de soldats et d’ouvriers pendant la Première guerre mondiale et leur retour ;
– recherche et patrimonialisation de la culture de Hué.
Ce colloque s’inscrit dans les manifestations organisées en 2023 à l’occasion du 50e anniversaire des relations officielles entre la France et le Vietnam.
Organisateurs :
Nguyen Phuong Ngoc
MCF HDR études vietnamiennes, IRASIA (UMR 7306)
thi-phuong-ngoc.nguyen@univ-amu.fr
Frédéric Roustan
MCF histoire, IAO (UMR 5062)
f.roustan@univ-lyon2.fr
Tran Dinh Hang
Chercheur, Institut de la Culture (Ministère de la culture, Vietnam)
navidongkhanh@gmail.com
Plus d’informations : [Cliquez ici]